Voyage dans le temps au siège de Parthenay en 1419 par M. la Fontenelle de Vaudoré
Une copie vidimée d'une charte du mois d'août 1419, qu’on peut considérer comme la charte originale elle-même, parce qu'elle a été faite la même année, en mars (qu'on ne s'étonne pas de cette coïncidence, l'année commençait alors à Pâques), me donne occasion de parler du siège de la ville de Parthenay, de la même année.
Ce fait d'armes important pour la province du Poitou et d'un certain poids dans la balance générale des grands événements de l'époque, et surtout le traité particulier qui le termina, n'avaient jamais été parfaitement connus.
On en savait quelque chose d'après les documents du temps , notamment par une lettre de Charles VI (1) et par Juvénal des Ursins (2) et d'autres écrivains de l'époque; mais c'est la charte dont M. Dorfeuille (3) a fait hommage à la Société, et sur laquelle j'ai rédigé cet article, comme rapport détaillé, qui fait connaître précisément à quelle condition l'armée du Dauphin, depuis Roi sous le nom de Charles VII, et ayant assumé sur sa tête l'autorité royale dans l'Ouest de la France, pendant la démence du Roi Charles VI, son père, consentit à la levée du siège de Parthenay.
On voit les mesures prises par chacune des parties pour la conservation de ses droits, et les précautions jugées nécessaires pour neutraliser, en quelque sorte, un point important, le château et la ville de Parthenay, et même la contrée qui en dépendait.
On comprendrait difficilement les causes qui amenèrent le siége de Parthenay, à l'encontre d'un grand vassal qui ne s'annonçait pas en rébellion ouverte contre son suzerain le comte de Poitou, et les conditions faites pour la levée de ce siège, si on ne connaissait pas exactement la position réelle des choses d'alors, pour le Dauphin-régent et Poitiers dont il avait fait sa capitale.
Disons donc quelques mots de généralité pour l'intelligence du sujet particulier à traiter ici.
Le Dauphin Charles, troisième fils du Roi Charles VI et de la Reine Isabeau de Bavière, de malheureuse mémoire, était devenu comte de Poitou, à la suite de son grand-oncle Jean, duc de Berry, et du Dauphin Louis; et il avait pris possession de cet apanage, au moment où les troubles, en France, devinrent de la nature la plus inquiétante.
Lorsqu'eut lieu l'entrée des Bourguignons et le massacre des Armagnacs à Paris, le Dauphin Charles fut sauvé de l'hôtel St-Paul par Tanneguy du Châtel qui l'enveloppa dans un linceul, et, monté sur le cheval que lui procura Robert-leMaçon (4), depuis son chancelier, ce prince chercha tout d'abord un asile à Poitiers.
Une des plus belles constructions du duc Jean de Berry, le château de Clain-et-Boivre (Le château triangulaire de Poitiers) dont le savant et vénérable collègue dont nous pleurons la perte, M. l'abbé Gibault, nous a fait un portrait si enchanteur (5), devint alors le Louvre ou les Tuileries du véritable Souverain de la France.
Mais à l'Est, vers Paris, étaient des provinces qui avaient pris parti contre lui, et qu'occupaient les Bourguignons et les guerriers du parti anglais; au Midi, à Bordeaux, se trouvaient les Anglais eux-mêmes; au Nord, c'était la Bretagne, dont le duc flottait entre les deux partis, et qui ne tarda pas, comme on disait alors, à se faire bourguignon.
Le Dauphin-régent devait assurer sa nouvelle capitale, en l'entourant d'un pays, sinon entièrement soumis, du moins dont il n'eût rien à craindre.
Ainsi il avait tout près de lui les possessions de la maison d'Anjou, qui venaient presqu'aux portes de Poitiers, à Mirebeau.
Mais, époux de la belle et vertueuse Marie d'Anjou, et gendre chéri de la reine de Sicile, duchesse d'Anjou, Yolande d'Aragon, le pouvoir de Charles n'avait rien à craindre de ce côté, il ne pouvait en espérer que des secours et de bons conseils.
Or, il était un grand vassal du comté de Poitou, dont les domaines s'avançaient jusqu'à cinq lieues de la capitale de la province, à Cramart, près Ayron. Je veux parler ici de Jean de Parthenay - l'Archevêque, véritable souverain de la Gâtine, comme puîné de la royale maison de Lusignan, et descendant du chef d'une ancienne peuplade fixée et possessionnée dans notre contrée.
Le sire de Parthenay s'était toujours montré attaché au parti bourguignon et prêt à entrer en opposition avec l'autorité royale; il était déjà âgé, sans enfant, et ses héritières naturelles étaient ses deux sœurs, savoir : Jeanne de Parthenay, mariée à Guillaume, comte de Tancarville et de Melun, et Marie de Parthenay, épouse de Louis de Châlons, comte de Tonnerre.
Sentant l'importance de la réunion de la Gâtine et de Parthenay, qui en est la capitale, au comté du Poitou, Charles VI avait traité avec Jean l'Archevêque pour avoir, à sa mort, ses importantes possessions.
Le Dauphin avait fait un pareil acte, mais cette sorte de convention de succéder ne devait avoir d'effet que pour l'avenir.
Or, la possession actuelle de Parthenay et de son territoire par les ennemis du Régent pouvait avoir un résultat désastreux pour la cause de celui-ci, et il était instant, dès-lors, de prendre des mesures à ce sujet.
La guerre civile désolait effectivement la France dans les premiers mois de 1419.
Le Dauphin s'était emparé de Tours, et, dans un voyage en Limousin, il s'assura que cette province résisterait aux efforts des Anglais, qui pouvaient arriver par la route de Bordeaux.
Mais on savait que Jean II l'Archevêque était de plus en plus en relation avec le parti bourguignon.
Or, ce seigneur avait nombre de bonnes forteresses au cœur du Poitou (6); et Parthenay, à dix lieues de Poitiers, occupé par l'ennemi, aurait sans doute obligé la Cour et le Parlement de prendre un refuge ailleurs.
C'était, du reste, une position dont il était utile, sous un autre point vue, de ne pas laisser prendre possession à d'autres.
Parthenay, au dire de Juvénal des Ursins, l'un des membres du Parlement de Poitiers dont j'écris l'histoire, après en avoir lu tous les registres; Parthenay était une ville trèsforte et même reputée imprenable, ayant trois paires de fossés et deux paires de murs qui l'entouraient.
Le château était aussi très-fort, et on n'y craignait pas la famine, car, au dire du même écrivain, il était suffisamment approvisionné de seigle, grain qui se garde dix ans ( je laisse toujours parler l'auteur), tandis que le froment ne se conserve guère.
De plus, la garnison était nombreuse et composée d'hommes de grand cœur, ou Francs, comme on le disait et comme on le dit encore dans le pays.
Ils étaient commandés en chef par deux vaillants chevaliers de la contrée et de la même maison , Guischard et Gilles d'Appelvoisin (7); ce dernier était plus connu sous le nom de messire Gilles.
Sous eux, on remarquait de nobles guerriers du même pays, dont les familles existent encore ou ne se sont éteintes que beaucoup plus tard et après avoir jeté de l'éclat, savoir : Guille ou Guillaume de la Court (8), Guillaume Perceval. Chabot (9), Jean Sauvestre (10), Guillaume Jousseaume (11), Micheau Baudouin (12), Jean de Nuchèze (13) et Jean Chauvereau.
Pour attaquer une place aussi forte et si en position d'être défendue, le Dauphin réunit un bon corps d'armée, composé des guerriers des différentes provinces soumises à l'ennemi qui s'étaient réfugiés près de lui, des contingents des pays en son pouvoir, et surtout de guerriers de la province de Poitou.
Le commandement de l'armée fut donné au prince Philippe d'Orléans, comte de Vertus (14), à qui le Régent concéda le titre de capitaine général du Roi et de lui Dauphin ès pays de Guienne et de Poitou, et au sire de Torsay (15), grand-maître des arbalétriers de France, et ces deux généraux avaient sous eux des capitaines expérimentés.
Parthenay fut donc investi, et on employa d'abord touts les moyens en usage pour arriver à une prompte réduction, sans pouvoir y parvenir.
Mais, plus tard, on usa aussi d'une tactique qui ne fut pas infructueuse, ainsi qu'on le verra bientôt. Il y avait, dans l'intérieur de la ville et au château, plusieurs gentilshommes poitevins, grands propriétaires et très-attachés au sol, dont les maisons et les domaines étaient hors de la ville et dans le surplus de la Gâtine, on leur fit notifier que s'il n'y avait pas capitulation, on confisquerait leurs biens et que tout d'abord on les séquestrerait, en commençant par abattre et détruire les bâtiments.
Pour quelques-uns, et d'abord pour ceux qui passaient pour les plus bourguignons, la menace fut suivie de l'effet.
Pendant ce temps, messire Gilles sortait touts les jours hors de la ville, bien monté et bien armé, invitant chacun des chevaliers dauphinois à venir rompre une lance avec lui.
Souvent le défi était accepté; et toujours vainqueur, tant grande était sa force, tellement supérieure était son adresse, il ne prenait jamais que le cheval de celui qu'il abattait, et un marc d'argent : tel était son taux, dit le chroniqueur ; c'était toute loyauté de sa part.
Il en était autrement de Lévesque, dit le Capitaine-Noir, véritable chef de brigands, qui se tenait le plus souvent dans les bois, et en sortait à la dérobée pour faire grand dommage à l'armée des assiégeants, en empêchant la venue des vivres, et en surprenant et mettant à mort, sans miséricorde, ceux qui s'écartaient.
Aussi les Dauphinois agissaient de la même manière avec les soldats de Lévesque; autant ils en prenaient, autant ils en pendaient. La mort par les armes leur semblait même trop douce et trop honorable pour de tels brigands.
Près de Parthenay est un vieux château qui a appartenu longtemps à une famille, l'une des plus anciennes et des plus illustres du Poitou, aux Châtaigner, qu'on a appelés, non sans raison , les Montmorency du Poitou (16).
Le vieux château de Thenessu (Château de Tennessus- Amailloux), était alors un château, bien fortifié et en rase campagne, susceptible de résister longtemps.
Bref, après plusieurs conférences, l'acte définitif qui mettait un terme au siège de Parthenay fut signé le 31 août 1419 à Parthenay-le-Vieux par le comte de Vertus, agissant en sa qualité de lieutenant et capitaine général du roi et du dauphin, régent du royaume, en Poitou et en Guienne.
Les prescriptions qu'il contenait furent scrupuleusement accomplies de part et d'autre. Messire Régnier Pot ayant été installé dans ses nouvelles fonctions, le sire de Parthenay prêta entre ses mains, en présence de Guillaume Cousinot, le serment d'observer fidèlement les conditions de la paix, d'obéir au dauphin comme à son seigneur naturel, et de n'introduire qu'un nombre limité d'hommes de guerre dans sa forteresse.
Les chevaliers et officiers du sire de Parthenay et les habitants de la ville jurèrent également d'être vrais et loyaux sujets du dauphin ; de ne pas souffrir que leur seigneur lui fît dorénavant la guerre, et surtout d'empêcher qu'à la mort de Jean Larchevêque la ville de Parthenay passât en d'autres mains qu'en celles du roi et du dauphin, suivant la teneur du contrat de 1416.
De son côté, Régnier Pot jura de défendre les intérêts de Jean Larchevêque et de ses sujets tant qu'il resterait chargé de garder son château, et de lui obéir en tout, sauf dans le cas où. il voudrait l'expulser de son poste.
Enfin, les chevaliers de l'armée du comte de Vertus jurèrent à leur tour d'observer fidèlement la paix et de ne commettre envers le sire de Parthenay ou ses vassaux aucun acte qui pût leur porter préjudice.
Le traité du 31 août accorda aux vaillants défenseurs de Parthenay le droit de rentrer immédiatement en possession de leurs domaines que l'on avait confisqué pendant le siège. Après l'accomplissement de ces formalités, la paix fut solennellement proclamée dans la ville et dans le camp ; la garnison évacua la place et l'armée royale leva le siège. Il avait duré quatre mois (23).
A peine la tranquillité était-elle rétablie en Gâtine que le dauphin en profita pour obtenir de Jean Larchevêque une nouvelle vente de ses domaines.
En effet, les contrats précédents de 1405 et de 1416 n'avaient jamais reçu d'exécution ; il était donc prudent de les faire renouveler ou confirmer.
C'est ce qui ne tarda pas à avoir lieu, ainsi qu'on pouvait le prévoir d'après certains passages du traité de Parthenay-le-Vieux.
Un troisième acte de vente fut passé à Bourges le 19 novembre 1419 : Jean Larchevêque se réserva, comme il l'avait fait antérieurement, l'usufruit de toutes ses baronnies; plusieurs terres, notamment le Fontenioux, ne furent point comprises dans la vente et demeurèrent la propriété du sire de Parthenay.
Le prix ne fut point changé ; il resta fixé à sept vingt et un mille écus d'or que le dauphin s'engagea à verser en plusieurs termes (24).
Cependant Marie et Jeanne de Parthenay n'avaient pas vu sans dépit leur frère aliéner au profit de la couronne les immenses domaines de la famille Larchevêque.
Elles protestèrent de nouveau contre cet acte et demandèrent sa nullité. Leurs prétentions étaient principalement fondées sur le contrat de mariage de Jeanne qui assurait la succession du sire de Parthenay à ses sœurs dans le cas où celui-ci n'aurait pas d'enfants. Mais tous leurs efforts furent inutiles.
Celle qui se montra la plus exaspérée fut Jeanne.
Nous avons dit plus haut qu'elle avait épousé le vicomte de Melun ; elle en eut une fille nommée Marguerite qui épousa Jacques d'Harcourt.
Ce baron partagea sans peine les regrets mortels que faisait éprouver à sa nouvelle famille la perte de la baronnie de Parthenay, et c'est peut-être à l'instigation de sa belle-mère qu'il essaya, en 1423, de s'emparer par ruse du château de Jean II Larchevêque.
Monstrelet, Pierre de Fenin et d'autres annalistes ont raconté cette tentative insensée qui coûta la vie à son auteur ; mais le récit le plus curieux est celui que M. Marchegay a inséré dans sa notice.
- Jacques d'Harcourt, qui revenait du Crotoy assiégé par les Anglais, se trouvait à Poitiers à la cour de Charles VII, lorsqu'il conçut l'idée d'aller voir son oncle à Parthenay, « lequel (le sire de Parthenay) luy fit grande chère et le receut honorablement.
Le dit de Harcourt regarda fort icelle place, qui semblait belle et forte, et convoita fort de l'avoir , s'imaginant et considérant que son oncle n'estait pas bien sage, comme l'on disait ; puis s'en retourna pensant qu'il retournerait une autrefois et qu'il aurait la place, s'il pouvait; car si luy et ses gens pouvaient entrer au chasteau ils seraient les plus forts ; ce qui luy semblait facile à exécuter, veu qu'au dit chasteau il y avait une issue qui s'en allait aux champs, laquelle il ouvrirait à force et mettrait gens par là, puis ferait lever le pont levis du costé de la ville, tellement qu'on ne pourrait secourir ceux du dedans.
Or, pour mettre son imagination à exécution il s'en vint à Parthenay et fit mettre une embuscade assés près du pont levis ou de l'entrée qui sortait du chasteau aux champs.
Entré qu'il fut au chasteau on luy fist bonne chère et il y disna, et ne se donnait on de garde de ce qu'il voulait faire.
Après le disner, il vint au seigneur de Parthenay, son oncle, et luy dit pleinement qu'il avait sa part au dit chasteau et qu'il fallait qu'il le gardast à son tour ; et que s'il y avait homme qui l'en voulust empêcher qu'il le tuerait et ferait mourir. Et dit-on que luy et ses gens tirèrent m leurs épées. Le seigneur et ses gens furent bien esbahis desquels aucuns se retirèrent en la tour du pont levis devers la ville lequel estait levé.
Si tinrent, la dite tour et commencèrent d'en haut à crier l'alarme, pourquoy le peuple de la ville s'esmeut tout à coup et apportèrent eschelles , si gagnèrent et abattirent le pont levis et entrèrent dedans la place à l'ayde de ceux de dedans la tour, puis tuèrent tous les gens du dit de Harcourt, lequel se retira en une tour en Las où il y avait de petites arbalestes et fenestres qui étaient bien estroites.
Toutefois on luy perça les deux cuisses d'une lance par une des lucarnes, et pour abréger il fut tué et ses gens furent jettez tous morts en la rivière et il fut enterré en un cimetière (25). »
Parmi les gens de Jacques d'Harcourt qui périrent avec lui dans sa folle entreprise, citons Jean de Herselannes, Jean de Fronssières et Philippe de Neuville (26).
La conduite déloyale de Jacques d'Harcourt et la terrible catastrophe qu'il s'était attirée causèrent une vive et fâcheuse impression sur l'esprit du sire de Parthenay. Ce faible vieillard, sur le point de descendre dans la tombe, avait la douleur de voir ses parents l'accabler de leurs obsessions pour s'assurer son riche héritage. Mais il ne pouvait changer la situation des choses.
La vente qu'il avait consentie au roi en 1419 l'avait définitivement dépouillé de ses domaines; il n'était plus maître chez lui. Toutes ses baronnies appartenaient maintenant à la couronne, et il n'en était plus que simple usufruitier. Néanmoins il paraît que Jean Larchevêque, cédant sans doute aux sollicitations de ses sœurs, chercha à faire annuler le contrat de 1419 (27).
Mais Charles VII, loin d'y consentir, ne songea qu'à user souverainement de ses droits de propriété sur Parthenay.
Par lettres patentes du 24 octobre 1425, Charles VII donna à Arthur de Richemont, qu'il venait de nommer connétable, toutes les seigneuries de Parthenay, Vouvent, Mervent, Secondigny, Coudray-Salbart, Béceleuf et Châtelaillon (28).
Jean Larchevêque, dans son impuissance, se soumit humblement et souscrivit même l'acte de donation. Il ne faut point s'en étonner : la faiblesse habituelle de son caractère ne fut pas la seule cause de ce nouveau changement dans sa volonté.
La tentative de Jacques d'Harcourt l'avait singulièrement irrité contre sa famille. Depuis ce fatal événement, il se laissa exclusivement dominer par l'influence royale. Aussi, non content d'avoir donné son consentement à la donation de 1425, il alla jusqu'à reconnaître formellement pour son héritier le connétable de Richemont, naguère encore son ennemi.
Il convoqua tous ses vassaux de Gâtine, tous les capitaines de ses places et leur fit prêter serment d'être bons et loyaux sujets du connétable, leur futur seigneur (29).
Aussitôt tous les vassaux de Parthenay, voulant faire preuve de dévouement et de fidélité envers celui que leur vieux maître avait désigné pour son successeur, s'empressèrent d'aller rejoindre Richemont qui se rendait alors à Bourges auprès du roi, accompagné d'une multitude de barons de la Bretagne, du Poitou, du Berry et de l'Auvergne (1425) (30).
Jean II Larchevêque mourut au commencement de l'année 1427 dans un âge fort avancé (31).
Il ne laissait aucun enfant de son mariage avec Brunissende de Périgord.
C'était un seigneur doux, pieux, charitable et chéri de ses vassaux. Une rente de deux setiers de seigle qu'il constitua sur la Bertrandière (paroisse de la Payrate), le 24 juin 1404, en faveur de la charité du Trêzain de Saint-Jean, nous fournit l'occasion de dire un mot de cette institution de bienfaisance, qui d'ailleurs n'était pas la seule dans notre ville.
(29) Mémoires de Guillaume Gruel sur le connét. de Richemont, coll. Petitot, Ire série, t. 8. — M. Mazas, dans sa belle et savante biographie de Richemont, commet une inexactitude. Il donne le nom de Jean de Villiers au seigneur de Parthenay qui légua sa baronnie au connétable : son nom véritable est Jean II Larchevêque.
On appelait Trêzain de Saint-Jean une aumône publique que l'on distribuait annuellement le jour de l'Invention de la Sainte-Croix, devant l'église Saint-Jean de Parthenay, dans le cimetière de cette paroisse.
Cette aumône se faisait depuis un temps immémorial. L'origine de sa fondation est inconnue. Les biens, dont elle se composait, consistaient la plupart en rentes, provenant des libéralités des seigneurs et des personnes riches de la ville.
L'administration et la distribution du Trézain étaient confiées primitivement aux membres de la fabrique de Saint-Jean de Parthenay.
Plus tard, au seizième siècle, ce fut un administrateur particulier qui en fut chargé. Dans la suite, les distributions se firent sous les halles de la ville.
Enfin, vers l'année 1681, le Trézain de SaintJean fut réuni à l'hôpital, dont il alla grossir les revenus (32).
Jean II Larchevêque créa, le 27 mars 1412, dans l'église Sainte-Croix, les trois dignités de chapier, diacre et sous-diacre, pour la dotation desquelles il donna trois métairies, les Bazillières, la Bertrandière et l'Ingremaillière (33).
On sait qu'il existait déjà dans cette église un chapitre fondé au XIIe siècle par les seigneurs de Parthenay. Il se composait d'un écolâtre, d'un chantre, de quatre chanoines et du curé de la paroisse, qui était en même temps chanoine. Trois vicaires perpétuels, un maître de psallette, quatre enfants de chœur et un sacristain leur avaient été adjoints.
Les seigneurs de Parthenay avaient la collation de tous ces bénéfices. Dans les processions publiques et autres cérémonies ecclésiastiques, le chapitre de Sainte- Croix jouissait du droit de préséance sur tout le clergé de la ville, tant régulier que séculier (34).
Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs et de la Gâtine du Poitou : depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolution par Bélisaire Ledain,...
1415 Siège de Parthenay d’Arthur de Richemont - Terres confisquées de Jean II l'Archevêque et données au dauphin Louis de France <==.... ....==> NOTE SUR JEAN II LARCHEVÊQUE ET SA SUCCESSION
Georges Ier de la Trémoille <==........==> Le château de Tennessus (commune d'Amaillou) érigée durant la guerre de Cent ans -Les de la Court du Fontenioux de Vernoux
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, la ville est sous domination de la couronne d'Angleterre après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenêt en 1152. De cette époque date la construction d'une vaste enceinte, qui remplace l'ancien rempart gallo-romain.
La guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons qui sévissait alors, ne justifiait que trop bien ces précautions. Comme le duc de Berry était un des principaux chefs du parti Armagnac, le roi Charles VI ordonna la confiscation de son comté de Poitou.
(1) Insérée dans le Recueil des Ordonnances, t. XII, p. 263.
(2) Histoire de Charles VI.
(3) M. Dorfeuille, né à St-Maixent, d'une ancienne famille du Poitou, qui a marqué surtout dans les derniers siècles, s'est beaucoup occupé de l'histoire de sa province. On lui doit plusieurs notices, entre autres une sur les Taifaliens, sur le Dragon de Niort, etc. M. Dorfeuille a donné à la Société des Antiquaires de l'Ouest des chartes, des manuscrits, etc. très-précieux pour le pays.
(4) On peut voir, à ce sujet, une ordonnance du 7 novembre 1420 portant concession à Robert-le-Maçon d'un péage en Anjou, à raison de ce service La circonstance relative au cheval y est positivement indiquée.
(5) Dans la Revue anglp-française, t. 1er.
(6) Vouvant, Mervent, Secondigny, le Coudray-Salbart, etc.
(7) La maison d'Appelvoisin a marqué grandement en Poitou, et elle n'est éteinte que depuis peu d'années. Il est ridicule de croire qu'elle vient d'Italie et qu'elle est la même que celle des Pallavicini.
Les Appel voisin sortent de la terre portant ce nom, entre la forêt de Chantemerle et la Châtaigneraye, en Bas-Poitou, vendue depuis peu d'années par Mme la marquise de la Brousse de Verteillac. Or, le nom de celleci est Tiercelin d'Appelvoisin de la Roche du Maine. D'Appelvoisin de la Roche du Maine, général français marquant du XVIe siècle, n'ayant qu'une fille unique, la maria à Tiercelin le lieutenant de sa compagnie d hommes d'armes, à charge d'unir les deux noms.
Des Appel voisin d'une branche cadette, notamment Bodinatière et Brebaudet, des environs de Fontenay-le-Comte, ont marqué dans les guerres de religion.
(8) Cette famille s'est éteinte vers Pouzauges, il y a environ un siècle.
(9) La maison de Chabot, encore existante et l'une des plus illustres du Poitou, remonte par titres à l'époque où a commencé l'usage des noms propres.
(10) Un Sauvestre est cité dans les mémoires du connétable de Richemont. Cette maison possédait la terre de Clisson-en-Boismé, près Bressuire, et c'est une héritière de ce nom qui l'a portée à un Lescure, du Midi de la France, venu en Poitou avec son oncle, l'un des évêques de Luçon.
==> Eglise St-Pierre de Boismé ancienne chapelle des Clisson (Sauvestre- DE SALGUES de LESCURE)
(11) Les Jousseaume ont possédé les terres de Comméquiers et de la Forêt-sur-Sèvre. Le marquis de la Bretèche, de cette maison, a marqué assez comme officier général pour qu'une médaille ait été frappée en son honneur.
(12) Famille éteinte vers la Roche-sur-Yon, il y a moins d'un siècle, dans les seigneurs de la Lierre, dont la terre a passé à un Gazeau.
(13) Cette maison, encore existante, a fourni un évêque de Châlons.
L'un de ses membres a comparu au procès-verbal de la grande réformation de la coutume du Poitou.
(14) Frère du duc d'Orléans.
(15) Il fut aussi grand-sénéchal du Poitou.
(16) Pour peu qu'on connaisse l'histoire du Poitou, on sait ce que furent les sires de la Roche-Posay et d'Abain. L'évêque de Poitou, de cette maison, était un homme lettré, et il a publié plusieurs ouvrages.
La branche cadette de Thenessu s'est éteinte pendant la révolution.
L'érudit Duchesne a écrit l'Histoire de la maison de Châtaigner, qui a donné son nom à la Châtaigneraie, petite ville du Bas-Poitou.
(17) Aussi, dans la charte sur laquelle on a fait cet article, on voit que l'idée fixe est une paix générale intérieure de la France, pour agir d'un commun accord contre les Angloys enciens ennemys de cest royaulme. La position politique des deux nations l'une envers l'autre, au commencement du XVe siècle et actuellement, semble être tout autre.
(18) Il serait facile ici de faire une note assez curieuse sur Guillaume Cousinot, mais cela mènerait trop loin
(19) Gruel, dans les Mémoires d'Artus de Richemont, parle aussi de Jéhan de la Chaussée qui prenait son nom de la terre de ce nom, près du Thouet et de Gourgé, et ainsi nommée d'une voie romaine dont j'indiquerai la direction plus tard.
(20) Cette famille vient de s'éteindre.
(21) Les St-Gelais étaient une branche de la maison de Lusignan, possessionnée sur les bords de la Sèvre-Niortaise.
Le sire de Parthenay, à cause du Coudray-Salbart, étendait sa domination jusque dans ces parages.
(22) Ord. des Rois de France, t. XII, p. 225.
(23) Copie vidimée du traité de Parthenay-le-Vieil, en date du 4 septembre 1419, qui m'a été communiquée à Poitiers par M. Charles Calmeil. — Il existe une autre copie de ce traité aux archives de la Soc. des Ant. de l'Ouest.
(24) Archives impériales, carton J. 183 n° 135.
(25) Not. sur les Larch., par Marchegay.
(26) Enguerrand de Monstrelet, vol. Il, p. 9, éd. 1572.
(27) Extrait des Généalogies de Sainte-Marthe, dans dom Fonteneau, t. 86..
(28) Collection Dupuy 634 (bibl. imp.). — Extrait de Robert du Dorât, dans dom Fonteneau, t. 79. — Thibaudeau, t. 2, p. 49. —
Ces lettres de 1425 données à Poitiers furent enregistrées à la chambre des comptes le 12 août 1426. Elles furent renouvelées à Tours le 9 avril 1434.
(30) Mémoires de Guillaume Gruel.
(31) Extrait des Généal. de Sainte-Marthe, dans dom Fonteneau, t. 86. — Gruel.
(32) Archives de l'hôpital de Parthenay.
(33) Inventaire manusc. des titres de Sainte-Croix de Parthenay.
(34) Pouillé général contenant les bénéfices de l'archevêché de Bordeaux, - Paris, Alliot, 1648. — Inventaire des titres de Sainte-Croix.

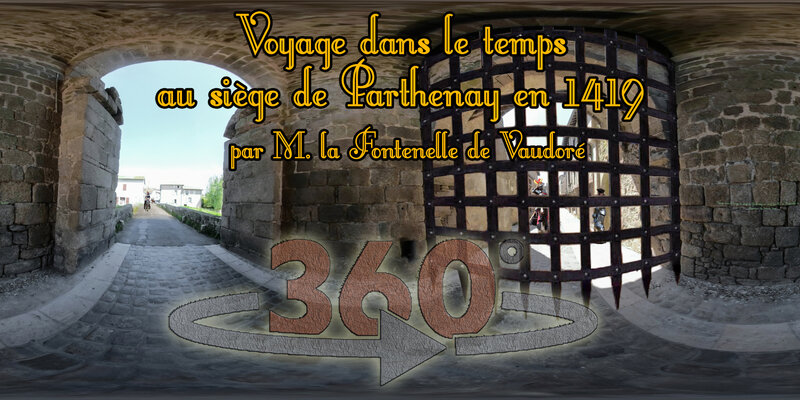





/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F37%2F24%2F1403127%2F134293380_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F46%2F09%2F1403127%2F133727451_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F18%2F77%2F1403127%2F133448742_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F10%2F1403127%2F133480631_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F1403127%2F117230027_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F50%2F1403127%2F116970300_o.jpg)