Les Guerres de l’Ouest - La Chouannerie, les Chouans de Bretagne
Des cinq départements de la Bretagne, le Morbihan était le plus solidement organisé. Aussi, lorsqu'au mois d'avril 1795, les républicains réussirent à endormir la vigilance des principaux royalistes, en leur faisant accepter les avantages de la paix trompeuse de la Mabilais, la plupart des chefs morbihannais refusèrent de la signer.
Ce fut cette contrée de la Bretagne qui soutint contre la Révolution la résistance la plus longue et la plus meurtrière ; qui fournit à la cause catholique ses soldats les plus nombreux et ses chefs les plus intrépides ; c'est à elle surtout que l'on doit l'homme qui par l'énergie de sa foi, sa vigueur physique, sa force morale, sa ténacité et sa rudesse même, semble incarner la Chouannerie bretonne, comme Charette et Cathelineau personnifient la résistance de la Vendée.
Les paysans bretons justifiaient-ils les espérances qu'avaient mises en eux Puisaye? Connaissaient-ils les motifs et le but du soulèvement ? Leur intrépidité, leurs moeurs militaires, le talent de leurs chefs méritaient-ils qu'on leur confiât les destinées de si nobles causes, comme aux Vendéens, leurs frères ?
« L'histoire manque aux chouans; elle leur, manque comme la gloire, et même comme la justice. Pendant que les Vendéens dorment tranquilles et immortels sous le mot que Napoléon a dit d'eux, et peuvent attendre, couverts par une telle épitaphe, l'historien qu'ils n'ont pas encore, les chouans n'ont rien, eux, qui les tire de l'obscurité.
Longtemps on leur a reproché d'avoir été des instruments aveugles d'ambitieux qui abusaient de leur crédulité pour faire triompher leurs intérêts personnels, d'avoir lutté pour un parti dont ils n'avaient pas à se louer, contre un parti dont ils n'avaient pas à se plaindre.
Les paysans bretons, comme les Vendéens, savaient pour quoi et pour qui ils se battaient. Ils poursuivaient à la fois la restauration du trône et le rétablissement des autels : c'était leur droit. Si d'ailleurs ils demandaient au drapeau des Bourbons d'abriter leurs plus chères revendications, ce n'était pas au gouvernement qui les y contraignait à leur en faire un crime.
Le caractère indépendant du peuple breton se fût volontiers accommodé d'une révolution dont les réformes n'auraient porté que sur les institutions politiques et sociales.
Peut-être même la substitution d'un gouvernement républicain au gouvernement monarchique, si surtout elle s'était produite sans secousses trop violentes, lui eut causé plus d'étonnement que d'irritation, à la condition qu'elle sût respecter sa foi. Mais il comprit bien vite que la religion ne courait pas de moins grands dangers que la royauté.
Il vit fermer les églises, chasser et guillotiner les prêtres ; il se vit interdire à lui-même toutes les manifestations de la foi qui jusque-là remplissaient sa vie entière. Il ne lui était permis de jouir des libertés politiques qu'à la condition de sacrifier la liberté sans laquelle les autres ne sont qu'une forme spéciale de l'esclavage, la liberté de la conscience.
La Révolution ne lui permettait pas de faire un choix entre les réformes qu'elle lui offrait. Il lui fallait ou les rejeter toutes ensemble, ou les accepter comme un « bloc » dont aucune parcelle ne pouvait se détacher. Etant donnée la profondeur de sa conviction religieuse, son parti fut bientôt pris : il les rejeta. Il confondit dans le même dévouement deux causes que la révolution confondait dans une même haine.
C'est ainsi que la royauté arriva à bénéficier de la haine que les Bretons vouaient aux persécuteurs de leur foi. Et la fidélité qu'ils lui témoignèrent dans ses malheurs fut plus grande que celle qu'ils avaient montrée au moment de sa gloire et de sa puissance.
Les royalistes voulurent mettre ces dispositions au service de leur cause. Sous l'influence des événements, les intérêts politiques, les passions étrangères, les mécontentements personnels acquirent la prépondérance, là où ils n'avaient d'abord été qu'une préoccupation secondaire. Mais considérée dans son origine, la chouannerie fut un soulèvement avant tout religieux.
Les pires ennemis étaient d'ailleurs contraints de le reconnaître. Même après quelques années de lutte, il eût suffi d'offrir avec sincérité la liberté religieuse pour faire tomber les armes des mains.
Le général républicain Krieg disait au représentant du peuple Bollet : « Les rebelles du Morbihan..., ont le fanatisme de la ci-devant religion, nous celui de la liberté. » Voici un témoignage plus explicite encore. Il est d'autant moins suspect que celui qui le portait était placé dans le pays même qu'on peut regarder comme le centre le plus actif du mouvement insurrectionnel. Faverot, commissaire du pouvoir exécutif à Vannes, écrivait, en 1796, au ministre de la police générale à Paris : « On se serait grandement trompé, si on avait cru qu'ils (les chouans) s'étaient armés pour la cause du trône. C'était bien la cause de la guerre civile dans l'esprit des chefs : ils se battaient pour le roi, et les paysans pour leurs prêtres. »
Hoche lui-même, de passage à Vannes, après avoir étudié tous les moyens de pacification, ose indiquer au Directoire la cause et le remède de la chouannerie : «... Je vous en conjure, ne vous mêlez pas de ce qui rapport au culte, si vous ne voulez pas rendre la guerre interminable".
Assurément les généraux et les commissaires de la république ne voulaient que faire connaître les motifs de la révolte. Ils ne songeaient pas à l'excuser. Notre époque est plus impartiale. Des écrivains qui ne vont pas jusqu'à proclamer la nécessité d'une insurrection en faveur de celle de nos libertés que la révolution revendique comme la plus précieuse, ne sont pas éloignés de regarder l'explication fournie par les adversaires de la Chouannerie comme sa justification. Ceux même qui regrettent les violences et les crimes qui furent commis de part et d'autre n'osent pas nier la légitimité du principe qui provoqua la guerre civile..
Agitez le milieu social le plus calme on apparence, vous verrez paraître à la surface les passions les plus viles, les instincts les plus odieux qui se cachaient dans les bas-fonds... Les chefs de la Chouannerie avouent qu'ils ont trouvé dans leurs troupes des soldats indignes qui déshonoraient leur parti en se livrant au pillage, à la satisfaction de haines particulières, à tous les excès... Sans doute, ils faisaient des répressions sévères; mais ils ne pouvaient connaître, encore moins prévenir toutes les fautes. S'ils ont la franchise de ne pas les dissimuler, ils ne veulent pas cependant qu'on rende coupable tout un parti des crimes individuels qu'ils sont les premiers à condamner, non plus que l'on ne songe aujourd'hui à rejeter sur les armées régulières les actes isolés que le code milliaire peut bien prévoir, mais qu'il ne réussit pas toujours à atteindre
Quand il s'agit des mesures violentes prises par les seils, ordonnées par les chefs et devenues la pratique courante des chouans, quelques-uns les ont regardées comme absolument blâmables et n'ont pas voulu qu'on invoquât les circonstances atténuantes. D'autres au contraire s'en sont faits les ardents apologistes : quand on lit les pièces de cet intéressant débat où il va de l'honneur de toute une génération qui lutta si énergiquement pour sauver sa foi, si on ne peut admirer des procédés dont on voudrait prévenir à jamais le retour, on sent bien des préjugés se dissiper et disparaître. Quand on hésite à accorder sa pleine et entière approbation, on craint encore davantage de condamner.
Ils enlevaient des caisses publiques.— Mais à qui appartenait l'or qu'elles renfermaient ? N'était-ce pas le tribut que la Convention prélevait injustement sur une population qui subissait la tyrannie plutôt qu'elle n'en reconnaissait la légitimité? Les chouans qui se donnaient comme les vrais défenseurs du pays — et qui l'étaient —, ne pouvaient-ils pas regarder comme à eux cet argent dont on n'avait le droit de se servir que dans l'intérêt du pays à qui on l'avait arraché ?
S'ils tuaient parfois sans pitié les prêtres jureurs et les magistrats jacobins qui leur tombaient entre les mains, c'est qu'ils se trouvaient en cas de légitime défense. C'étaient là leurs plus mortels ennemis. Les uns dénonçaient le lieu de leur retraite, les autres les faisaient traquer et massacrer comme des bandits.
Quand ils voyaient leurs prêtres ou leurs chefs impitoyablement mis à mort par les républicains, ils croyaient avoir le droit de recourir à des représailles. Ils se trompaient. Le droit de représailles n'existe pas. Mais l'historien impartial ne peut avoir des termes différents pour qualifier des actes semblables et ne doit pas nommer assassinats chez les chouans ce qu'on appelait exécutions chez leurs adversaires.
Leur consigne était de ne pas faire de prisonniers. Les apologistes qui veulent les justifier on tout n'ont pas oublié de soutenir que cette cruelle mesure est une nécessité malheureuse des guerres civile.
Il eut été plus habile de rappeler que les chouans n'y recouraient pas souvent et de raconter qu'un jour ils abandonnèrent un chef que leurs instantes prières ne purent amener à épargner les vaincus.
S'ils avaient condamné ce prétendu droit, ils eussent été plus recevables à dire que l'exercice on devient particulièrement odieux dans le cas où les prisonniers ont obtenu la promesse de la vie en vertu d'une capitulation sur le champ de bataille, et qu'on ne cite pas un seul exemple où les chouans aient violé leur promesse.
Mais il est un parti en France qui doit s'interdire d'apprécier sévèrement la Chouannerie, c'est celui qui révolta les paysans bretons par sa tyrannie insupportable, et qui employa, pour les combattre, des procédés réprouvés par le droit des gens.
Il y eut bien un brigandage organisé en Bretagne. Pendant la guerre civile, le pays fut inondé par des bandes qui n'avaient d'autre mission que de piller, d'incendier et d'assassiner. A les juger sur les apparences, on eût dit que ces gens appartenaient à la Chouannerie : ils en portaient le costume ; ils en avaient la cocarde blanche, le scapulaire et le chapelet; ils savaient prier « le ci-devant Bon Dieu » et crier : « Vive le roi ». — Mais ils n'avaient de chouan que le nom et l'habit. La république avait recruté des gens perdus de vices dans les bagnes, les prisons et les rues. Elle en avait composé des bandes, puis elle les postait le long des chemins ou les expédiait contre les villages. Leur mission consistait à commettre les crimes les plus horribles, que la ressemblance du costume ferait aisément attribuer aux soldats de la Chouannerie.
Si ce procédé était déloyal, il était bien choisi et il ne réussit que trop bien. La calomnie fut habilement exploitée; on parvint à égarer l'opinion; elle enveloppa dans une même réprobation les vrais chouans qui combattaient la convention en soldats, et les faux chouans qui la servaient en bandits.
On ne s'y trompa en Bretagne, au moins pondant la Révolution. Mais une sorte de fatalité devait poursuivre les chouans : non seulement leur nom était en horreur dans le reste de la Franco, grâce à leur assimilation avec des criminels ; il devait aussi perdre l'estime et l'admiration qui s'étaient d'abord attachés à lui dans le pays même où il avait été glorieusement porté.
Une nouvelle confusion se produisit sous le premier Empire et sous le gouvernement de Juillet. Le nom de chouan servit à désigner des gens qui n'y avaient aucun droit. Ils refusaient d'obéir à un pouvoir auquel ils ne voulaient pas reconnaître le droit de leur commander. Mais, loin que leur révolte eût des raisons sérieuses comme celle qu'ils prétendaient continuer, elle est condamnée par les principes mêmes qui expliquent et qui justifient l'insurrection de 1793 et 1795.
Les premiers chouans prenaient les armes contre des adversaires qu'ils avaient raison de considérer comme des perturbateurs de la société et des persécuteurs de leur foi. Mais le temps avait accompli son oeuvre d'apaisement et de pacification. La religion catholique, officiellement proclamée religion de la grande majorité des Français, jouissait d'un régime fait de tolérance et de liberté, qui, sans être l'idéal, ne laissait pas d'être supportable. Quant au pouvoir, accepté, consenti, ou même voulu par la nation, il avait droit à l'obéissance de ceux mêmes dont il n'avait pas obtenu les sympathies.
Les rôles étaient donc changés. Ce qui était juste au temps de la Convention devenait, sous Napoléon et Louis-Philippe, criminel, indépendamment de l'opinion de ceux qui se soulevaient dans des circonstances si différentes. Les nouveaux révoltés voulaient qu'on les regardât comme les continuateurs de la grande Chouannerie : mais en réalité, ils n'avaient d'autre but que d'échapper aux fatigues et aux dangers du service militaire. Tandis que les chouans ne repoussaient la conscription que pour attaquer ceux qui voulaient la leur imposer, eux se cachaient pour n'avoir pas à combattre. C'est avec raison que le gouvernement les regardait comme des déserteurs et des réfractaires. C'est avec raison aussi que la population voyait en eux des ennemis dangereux : condamnés à l'oisiveté dans la période la plus active de la vie, d'une moralité suspecte, prenant par force ce qu'on ne leur donnait pas de gré, exerçant une sorte de terreur dans leur voisinage, quand ils ne se cachaient pas par peur du gendarme, ils ont laissé les plus désolants souvenirs.
Le nom de chouan dont ils avaient l'habileté de couvrir leurs méfaits devint peu à peu, grâce à leur triste renommée, une sorte de flétrissure dans le pays même, où il avait d'abord signifié héroïsme et dévouement.
Voilà comment on peut expliquer la contradiction apparente si souvent signalée dans les appréciations de la population bretonne, qui exècre, le nom de chouan, tout en se montrant remplie de vénération pour ceux qui les porteront les premiers. Ceux-là... elle n'a jamais varié sur leur compte : elle les a toujours regardés comme des héros, presque comme des saints...
C'est sans doute, par ce que les chouans ont été souvent assimilés à des gens, avec lesquels il semble qu'on ne pût jamais les confondre, que, beaucoup de leurs amis ont hésité non seulement à les réhabiliter, mais encore à mettre en lumière leurs mérites les plus incontestés.
En voyant les préventions dont ils étaient l'objet, on n'a toujours osé rendre hommage même à leurs qualités militaires que leurs ennemis ne pouvaient s'empêcher d'admirer. La conspiration du silence a suivi la conspiration de la calomnie.
Ici pourtant leurs apologistes avaient la partie belle : il ne s'agissait plus de justifier, mais de raconter.
Les chouans, avaient adopté une tactique, où les guérillas se couvrirent de gloire vers la même époque, et où les francs-tireurs s'illustraient naguère encore. Comme les premiers faisaient à nos soldats la guerre de montagnes, les autres aux Allemands la guerre de ravins et de bois eux faisaient aux républicains la guerre de forêts et de buissons.
C'était ce genre de guerre que Du Guesclin avait déjà inauguré en Bretagne pendant la guerre de Cent ans : il lui avait été inspiré par la configuration du sol et par le caractère des soldats qu'il recrutait. Sous la Révolution, l'ennemi n'était plus le même; mais le terrain n'avait pas changé, et les descendants des partisans de Du Guesclin ressemblaient bien à leurs pères.
Cette guerre, que des troupes régulières répugneraient à faire, était, aux deux époques dont nous parlons, une nécessité. Est-ce des troupes de Du Guesclin ou de celles de la Chouannerie que l'on a porté ce jugement que la raison même semble avoir dicté : « Ce qu'il fallait d'ailleurs, c'étaient des hommes jeunes, pauvres, endurcis aux privations, surtout connaissant à fond le pays par une longue habitude, capables de se retrouver par certains indices au milieu de l'immensité des landes, de l'épaisseur des bois, sachant les sentiers écartés, les chemins perdus, les défilés des routes, les clairières inconnues des forêts susceptibles d'offrir un refuge en cas de poursuite, dos fourrés où l'on peut s'embusquer
Qui réunit mieux ces conditions que des paysans jeunes et bien choisis, de vigoureux gars, comme on les appelle encore en Bretagne ?...
Nous empruntons cette citation à un des maîtres dont l'opinion fait loi en histoire. Voir Siméon Luce : Bertrand du Guesclin, p. 75.
C'est à lui que nous devons aussi l'idée du rapprochement que nous avons établi entre les deux époques. : « Cette vie de surprises, d'embuscades, d'escarmouches perpétuelles, cette chasse à l'affût dans les genêts, les bruyères offrent plus d'un trait de ressemblance avec l'existence que menèrent les chouans, dans les mêmes parages, à l'époque de la Révolution. »
En 1795, le Morbihan comprenait à lui seul de douze à quatorze bandes de partisans qui ne concertaient de mouvements d'ensemble que dans de très rares circonstances. Unies entre elles par la communauté du but, elles étaient presque indépendantes les unes des autres dans leurs opérations. Dociles à la voix de leur chef, les soldats d'une division se réunissaient brusquement ; ils faisaient une expédition hardie, délivraient un convoi do prisonniers, attaquaient un poste ennemi, favorisaient un débarquement…… La campagne durait huit jours, un mois, rarement davantage. Quand elle était terminée, ils se dispersaient, rentraient chez eux, se livraient aux occupations ordinaires, pondant que leur chef, la main frémissante toujours étendue sur eux, pour les rassembler en un clin d'oeil, continuait à surveiller le pays et à guetter les événements.
Ce partage des troupes de la Chouannerie multipliait ses forces, on lui permettant de diriger les attaques les plus imprévues sur un grand nombre de points. Les généraux républicains contraints d'accepter un genre de guerre qu'ils ne connaissaient pas aussi bien, obligés de répartir en un grand nombre de colonnes disséminées dans le pays leurs soldats plus habitués aux manoeuvres régulières, divisaient les leurs. « L'insurrection de la rive droite de la Loire est bien autrement redoutable, que n'a pu l'être celle de la rive gauche », s'écriait Hoche éperdu.
Si les Bretons s'étaient massés en grandes lignes, comme les Vendéens et qu'ils eussent voulu combattre en rase campagne, leur sort était connu d'avance : jamais leur nombre et leur intrépidité n'auraient pu avoir définitivement raison d'adversaires également courageux qui à l'avantage de posséder des armes incomparablement plus puissantes joignaient une supériorité tactique incontestable.
— Leur éparpillement ne leur permettait pas d'avoir de « ces grandes journées que le soleil et la gloire éclairent à l'envi de leurs rayons ». Mais la guerre n'en était pas pour cela moins meurtrière pour leurs ennemis et pour eux-mêmes :
« ils tombaient dans des combats obscurs, livrés par des héros ignorés ». Le pays était devenu un vaste champ de bataille, où la fusillade éclatait tantôt sur un seul point, tantôt sur plusieurs à la fois et ne se taisait jamais, où de nuit comme de jour, il y avait des marches et des contremarches perpétuelles, où, quand on croyait surprendre enfin un ennemi jusque- là insaisissable, il fallait songer à échapper à une autre troupe qui voulait vous surprendre à son tour, où il fallait toujours avoir la main sur ses armes, et même pendant son sommeil, où, pour un chouan qui tombait, six républicains mordaient la poussière, si bion qu'on ne craindrait pas de louer l'habileté des chouans et même le succès de leurs armes, si l'on ne se rappelait que c'était des Français qui se trouvaient sur le passage de leurs balles.
Parfois leur histoire parait atteindre la grandeur épique.
Le Garrec, Eugène
La Virée de Galerne le 3 Novembre 1793 – La Bataille de Fougères (synthèse) <==.... ....==> La Virée de Galerne – Octobre 1793, La Bataille de Fougères.
Le décret impérial du 25 mai 1804 (5 prairial de l'an XII) pris par Napoléon Bonaparte alors premier consul de la République, prévoit le transfert de la préfecture de la Vendée de Fontenay-le-Comte, ancienne capitale du Bas-Poitou, à la Roche-sur-Yon. Napoléon part de Rochefort, il atteint le territoire vendéen le dimanche 7 août en début de soirée......
Le traité de La Mabilais est un accord de paix signé le 20 avril 1795 dans le manoir de La Mabilais, à Rennes, entre les Chouans et la République française.

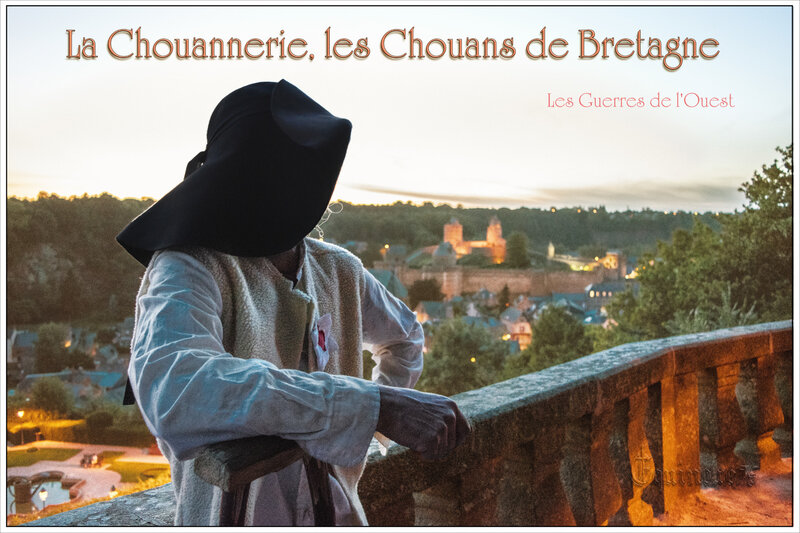



/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F64%2F1403127%2F134371382_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F93%2F35%2F1403127%2F134167667_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F66%2F54%2F1403127%2F134137344_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F1403127%2F117230027_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F50%2F1403127%2F116970300_o.jpg)